
Le texte qui suit est une traduction d’un texte en anglais. Il revient sur une idée largement répandue, aussi bien chez les marxistes que chez leurs opposants, selon laquelle Marx associerait nécessairement le socialisme au contrôle de l’État. L’auteur y décrit le récit habituel qu’on trouve souvent en ligne : une succession allant du capitalisme au socialisme (avec un État dirigé par la classe ouvrière), puis enfin au communisme, marqué par la disparition des classes, de l’argent et de l’État. Le texte souligne que ce récit courant ne correspond pas réellement à la pensée de Marx.
Il existe une idée très répandue, propagée à travers tout le spectre politique, aussi bien par des marxistes que par des anti-marxistes, selon laquelle, pour Marx, le socialisme consiste en un contrôle de l’État, ou du moins suppose nécessairement ce contrôle étatique.
Et cela n’a rien de surprenant. Après tout, dans le Manifeste du Parti communiste, le texte de Marx et Engels le plus lu, Marx énumère dix mesures à appliquer immédiatement après que la classe ouvrière a saisi le pouvoir d’État, et celles-ci impliquent une vaste nationalisation ainsi qu’une centralisation stricte. Évidemment, cela ne peut pas se faire sans État.
Mais, avant de nous attaquer à ce point, revenons un peu en arrière, pour les débutants, et partons de ce que la plupart des marxistes savent déjà. Pour Marx, l’État est quelque chose qui doit finir par être aboli. Le communisme est, après tout, une société sans classes, sans argent et, bien sûr, sans État. Pour lui, l’existence de l’État suppose nécessairement une aliénation politique. En effet, les forces sociales que les individus développent entre eux leur sont aliénées parce qu’elles sont transférées à l’État, et ainsi toutes leurs actions se trouvent médiatisées par les bureaucraties étatiques. Dès 1844, lorsqu’il écrit la Critique de la philosophie du droit de Hegel, il affirmait déjà : « Dans une véritable démocratie, l’État politique disparaît. » Cependant, selon le récit courant, avant que l’État puisse être aboli, il doit d’abord être conquis par la classe ouvrière, utilisé pour instaurer le socialisme, et, une fois le communisme à l’horizon, l’État s’éteindra naturellement.
Voici donc le récit que l’on retrouve couramment en ligne : D’abord, il y a le capitalisme — avec les marchés, l’État, les classes, et tout ce qui va avec. Ensuite, le socialisme apparaît quand les travailleurs prennent le pouvoir — sous le socialisme, l’État et les classes existent encore, mais sous la domination de la classe ouvrière. Enfin, une fois que la bourgeoisie a été vaincue, les classes, l’argent et l’État disparaissent enfin, et nous avons le communisme. C’est un récit extrêmement courant, mais ce n’est pas celui de Marx.
Phase inférieure et phase supérieure
Tout d’abord, pour éviter toute confusion, il faut préciser que Marx n’a jamais distingué entre socialisme et communisme, dans le sens où le premier viendrait d’abord et le second ensuite. Il n’utilisait d’ailleurs pas souvent le mot « socialisme », préférant employer « communisme », et lorsqu’il utilisait « socialisme », c’était généralement de manière interchangeable avec communisme, comme c’était l’usage courant dans la théorie socialiste de son époque.
Les seules fois où Marx ou Engels ont réellement distingué socialisme et communisme, c’était pour désigner par « socialisme » des tendances socialistes auxquelles ils s’opposaient. Par exemple, dans une préface du Manifeste communiste, Marx et Engels écrivent :
« En 1847, le socialisme était un mouvement de la classe moyenne, le communisme un mouvement de la classe ouvrière. Le socialisme était, du moins sur le continent, “respectable” ; le communisme était tout le contraire. Et comme notre conviction, dès le départ, était que “l’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre de la classe ouvrière elle-même”, il ne pouvait y avoir aucun doute sur lequel des deux noms nous devions adopter. D’ailleurs, nous n’avons jamais cessé depuis de le revendiquer. »
La distinction populaire entre socialisme et communisme, selon laquelle le socialisme viendrait d’abord et mènerait ensuite au communisme, a été popularisée par Lénine. Or, Marx a bien fait une distinction importante, mais d’un autre ordre : dans sa Critique du programme de Gotha, il distingue entre la phase inférieure du communisme et la phase supérieure du communisme. Dans la phase inférieure, les individus doivent travailler en échange de bons de travail – ceux-ci ne sont pas de l’argent, car ils ne peuvent pas être accumulés. Ils fonctionnent un peu comme un ticket de cinéma : on l’utilise une fois, puis il devient invalide. Comme ils ne peuvent être accumulés, ils ne peuvent pas être transformés en capital ; de ce fait, ils ne sont pas capitalistes. Ces bons de travail peuvent ensuite être échangés contre divers produits. En d’autres termes, la phase inférieure du communisme conserve encore une incitation matérielle au travail, puisque la quantité de bons reçus dépend du nombre d’heures travaillées.
Une fois que la société atteint un niveau suffisant de développement, que la productivité croît au point de permettre l’abondance, et que les individus se sont pleinement socialisés dans ce nouveau mode de vie, on entre alors dans la phase supérieure du communisme. Les bons de travail ne sont plus nécessaires et sont remplacés par le principe : De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins.
Par la suite, c’est Lénine qui popularise l’idée d’appeler « socialisme » la phase inférieure du communisme, et « communisme » la phase supérieure. Mais il faut noter que, qu’il s’agisse de la phase inférieure ou de la phase supérieure, il s’agit déjà d’une société sans argent, puisque l’argent est remplacé par des bons de travail. Et si elle est sans argent, elle est également sans classes : sans argent, il n’existe plus de classe qui détient le capital et qui exerce son pouvoir sur le reste de la société. Par conséquent, elle est aussi sans État, puisque pour les marxistes, l’État n’est rien d’autre que l’instrument par lequel une classe exerce son pouvoir sur les classes subordonnées. Pas de classes, pas d’État.
Il existe plusieurs indices très clairs que Marx ne distingue pas entre socialisme et communisme comme deux étapes d’un même développement. Par exemple, dans la Critique du programme de Gotha, il écrit :
« Ce dont il s’agit ici, c’est d’une société communiste, non pas telle qu’elle s’est développée sur ses propres bases, mais au contraire telle qu’elle sort de la société capitaliste ; société qui, à tous égards – économique, moral, intellectuel – porte encore les stigmates de l’ancienne société dont elle est issue. »
Si le communisme n’apparaissait qu’après une longue période de développement du socialisme, cette citation n’aurait aucun sens. Au contraire, il est clair que, même lorsqu’il ne distingue pas entre phase inférieure et phase supérieure, Marx parle du communisme comme de ce qui émerge directement du capitalisme. Ainsi, Lénine commence à utiliser le terme « socialisme » pour désigner la « phase inférieure du communisme », ce que Marx n’a jamais fait. Certaines de ses formulations diffèrent donc de celles de Marx, mais à ce stade, le récit de Lénine reste essentiellement celui de Marx, avec seulement quelques changements terminologiques. Dans les deux cas, socialisme et communisme renvoient à une société sans argent et sans classes. Le récit déformé, celui qui domine aujourd’hui, n’apparaîtra vraiment qu’après la mort de Lénine. Toutefois, déjà ici, une certaine confusion s’installe : de nouveaux lecteurs de Marx, ayant en tête la distinction léniniste entre socialisme et communisme, se retrouvent déconcertés par la façon dont Marx emploie le terme « communisme ». Mais il faut aller plus loin pour clarifier – ne fermez pas la vidéo maintenant.
Alors, si la phase inférieure comme la phase supérieure du communisme sont sans État, qu’en est-il des mesures du Manifeste communiste ? Puisqu’elles exigent centralisation et nationalisation entre les mains de l’État, elles supposent évidemment l’existence de l’État ; et parce qu’elles impliquent aussi une certaine forme d’imposition, elles supposent l’argent – et donc tous les autres éléments que le communisme, qu’il soit de phase inférieure ou supérieure, est censé abolir.
Eh bien, il ne s’agit pas de mesures destinées à établir le mode de production socialiste lui-même – cela n’est dit nulle part. Les gens présument que la prise de pouvoir par la classe ouvrière est le socialisme, mais Marx ne dit jamais cela. S’il l’avait dit, ce serait en contradiction avec sa propre conception. Des choses comme l’imposition et la nationalisation présupposent encore la propriété, l’argent et l’accumulation de capital, c’est-à-dire tous les éléments que Marx analyse comme caractéristiques du mode de production capitaliste. Les mesures du Manifeste ne concernent donc pas le socialisme, mais bien la période de transition.
La période de transition
Période de transition, tu pourrais dire, qu’est-ce que c’est que ça ? Selon le récit commun, on a le capitalisme, puis le socialisme est instauré lorsque la classe ouvrière s’empare du pouvoir d’État, et après une longue période de développement, on arrive enfin au communisme. Mais Marx affirme clairement, par exemple dans la Critique du programme de Gotha, que :
« Entre la société capitaliste et la société communiste se situe la période de transformation révolutionnaire de l’une en l’autre. À cette période correspond également une période de transition politique dont l’État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat. »
Si tu veux savoir ce qu’est une dictature du prolétariat, je t’encourage à regarder la troisième partie de ma collaboration avec Anarchopac et Red Plateaus, où je développe ce sujet. Le mot dictature ici ne signifie pas ce qu’il signifie dans le langage courant aujourd’hui – le règne d’un dictateur – mais plutôt « autorité absolue ». La dictature du prolétariat est l’autorité absolue de la classe ouvrière, tout comme le capitalisme est la dictature de la bourgeoisie, l’autorité absolue de la classe capitaliste. Comme Marx l’affirme clairement, et contrairement à ce que prétendent beaucoup, la dictature du prolétariat n’est PAS le socialisme ou la phase inférieure du communisme, car c’est le moyen par lequel la classe ouvrière impose sa volonté aux autres classes. Or le socialisme, ou phase inférieure du communisme, est une société sans classes. En effet, si l’on affirmait que la dictature du prolétariat EST le socialisme (ou, selon la terminologie de Marx, le communisme inférieur), on en viendrait à l’absurde conclusion que « la transition du capitalisme au communisme, c’est déjà le communisme ».
On peut donc corriger le récit mentionné plus haut en le reformulant selon ce que pensaient Marx et d’autres grands théoriciens marxistes comme Rosa Luxemburg ou Lénine. D’abord, il y a le capitalisme. Ensuite, les travailleurs s’emparent du pouvoir – c’est la période de transition, ou dictature du prolétariat. L’État, les marchés et les classes, en d’autres termes le capitalisme, existent encore, mais avec la classe ouvrière désormais au pouvoir. Le processus de suppression des classes commence. Une fois que la classe ouvrière a vaincu la bourgeoisie, la phase inférieure du communisme est instaurée : il n’y a plus d’État, plus d’argent, plus de classes, mais il reste encore des incitations matérielles au travail. Après une longue période de développement, apparaît le communisme supérieur, qui, tout comme la phase inférieure, n’a ni État, ni argent, ni classes, mais où les incitations matérielles sont remplacées par l’accès libre aux produits de la société.
Ainsi, les mesures inscrites dans le Manifeste du Parti communiste ne sont pas des mesures visant à établir le mode de production socialiste – d’ailleurs elles ne le peuvent pas, car aucune de ces mesures n’implique de changements fondamentaux dans le mode de production – mais bien des mesures destinées à la période de transition, des mesures par lesquelles la classe ouvrière impose sa volonté aux autres classes.
Maintenant, certains diront : peu importe qu’on dise que l’État existe dans la période de transition ou dans la période socialiste, ce n’est qu’une différence sémantique, et cela ne change rien au fait que Marx voyait l’État comme nécessaire à l’établissement du socialisme. C’est tout à fait juste, et donc il faut aller encore plus loin, car l’histoire ne s’arrête pas là. Après tout, le développement de la pensée de Marx ne s’est pas arrêté à la première parution du Manifeste du Parti communiste – à ce moment-là, l’un des développements les plus importants de sa réflexion n’avait pas encore eu lieu. En 1871, il se produisit un événement qui bouleversa complètement la pensée de Marx sur l’État : la Commune de Paris.
La Commune de Paris
La Commune de Paris fut un gouvernement établi par les ouvriers révolutionnaires de Paris, qui mit en place une forme radicale de démocratie permettant aux travailleurs ordinaires de participer activement à la prise de décision politique. Elle réalisa des avancées incroyables dans la pratique politique et dura deux mois avant d’être écrasée par l’armée française dans un massacre sanglant.
Après cet événement, ce n’est pas que les vues de Marx aient changé sur un simple caprice. Il a toujours insisté sur le fait qu’une théorie politique doit être nourrie par les développements historiques, et pour Marx, cet événement fut d’une importance historique extrême, car il le considéra comme le premier exemple historique de dictature du prolétariat. La Commune montra concrètement ce que signifie la prise du pouvoir par les travailleurs.
Cet événement fut si important que, l’année suivante, Marx et Engels rédigèrent une nouvelle préface au Manifeste du Parti communiste, dans laquelle ils déclarèrent que les mesures révolutionnaires énumérées dans le Manifeste étaient désormais devenues obsolètes :
« …aucun accent particulier n’est mis sur les mesures révolutionnaires proposées à la fin de la section II. … compte tenu de l’expérience pratique acquise, d’abord lors de la Révolution de février, puis surtout dans la Commune de Paris, où le prolétariat a exercé le pouvoir pendant deux mois entiers, ce programme est devenu caduc sur certains points… Une chose fut surtout démontrée par la Commune, à savoir que la classe ouvrière ne peut pas simplement s’emparer de la machine d’État toute prête et l’utiliser pour ses propres fins. »
Ainsi, après l’expérience de la Commune, Marx et Engels conclurent non seulement que le programme révolutionnaire en dix points qu’ils avaient proposé auparavant était devenu caduc sur de nombreux aspects, mais aussi que l’État tel qu’il existe ne peut pas simplement être utilisé par la classe ouvrière à son avantage. Il est par nature bourgeois, et doit être détruit puis remplacé par de nouvelles institutions radicalement démocratiques et ouvrières.
De plus, dans le Manifeste original, le chapitre 3 contenait la phrase : « En Allemagne, c’est la tâche du véritable parti révolutionnaire de réaliser la centralisation la plus stricte. » Après l’expérience de la Commune, le Manifeste fut mis à jour par une note rejetant cette affirmation. Elle précisait qu’il s’agissait d’un malentendu, car on croyait à l’époque – grâce aux falsifications bonapartistes et libérales – que l’administration centralisée française avait été introduite par la Révolution française et utilisée par la Convention comme arme décisive contre les royalistes, les fédéralistes et l’ennemi extérieur. Mais en réalité, tout au long de la Révolution, jusqu’au 18 Brumaire, l’administration des départements, arrondissements et communes était assurée par des autorités élues librement par les électeurs, qui agissaient de manière autonome dans le cadre des lois générales. Ce fut précisément cette autonomie locale et provinciale, semblable au modèle américain, qui constitua le levier le plus puissant de la Révolution. Napoléon, dès son coup d’État du 18 Brumaire, s’empressa de la remplacer par une administration de préfets – toujours en place aujourd’hui – qui, dès le départ, fut un pur instrument de réaction.
En résumé, l’appel à la stricte centralisation fut reconnu comme une erreur, car Marx et Engels avaient cru que l’administration centralisée française avait un caractère progressiste et révolutionnaire, alors qu’ils comprirent par la suite qu’elle était au contraire un « pur instrument de réaction ». En opposition à cela, ils affirmèrent que le véritable levier de la révolution n’était pas la centralisation, mais l’autogouvernement local. Pour une analyse plus détaillée, il faut se tourner vers La Guerre civile en France, écrit la même année que la Commune. C’est là que l’on voit à quel point la pensée de Marx sur l’État avait évolué. Dans ce texte, Marx affirma que la Commune représentait bien une dictature du prolétariat, mais il ajouta aussi à propos de ses politiques : « il n’y a rien de socialiste dans celles-ci, si ce n’est leur tendance ». En d’autres termes, dans la Commune, la classe ouvrière détenait le pouvoir, mais il n’y avait rien de spécifiquement socialiste dans ses mesures. Cela est incohérent si l’on confond dictature du prolétariat et socialisme. Au contraire, il s’agit de la forme politique qui mène progressivement au socialisme.
De même que Marx avait compris que l’autogouvernement local fut le moteur de la Révolution française, il comprit que ce serait la Commune, et non l’État, qui mènerait la révolution prolétarienne.
Il vit dans la Commune une vision de :
« Toute la France … organisée en communes laborieuses et autogouvernées, l’armée permanente remplacée par des milices populaires, l’armée de parasites d’État éliminée, la hiérarchie cléricale remplacée par des instituteurs, les juges de l’État transformés en organes communaux, le suffrage national non plus une manipulation au service d’un gouvernement tout-puissant, mais l’expression délibérée des communes organisées, les fonctions étatiques réduites à quelques tâches d’intérêt général national. »
Ainsi, même si Marx précisait que la dictature du prolétariat aurait encore un État, ce serait un État radicalement différent de l’État bourgeois : réduit à « quelques fonctions d’intérêt national », sans moyens de coercition centralisée, et avec une armée permanente remplacée par des milices populaires issues de la classe ouvrière elle-même.
Et ce n’est pas tout : Marx alla jusqu’à dire :
« Le véritable antagonisme de l’Empire lui-même – c’est-à-dire du pouvoir d’État, de l’exécutif centralisé, dont le Second Empire n’était que la formule la plus épuisée – c’était la Commune… Ce fut donc une Révolution non pas contre telle ou telle forme de pouvoir d’État – légitime, constitutionnelle, républicaine ou impérialiste – mais une Révolution contre l’État lui-même, contre cet avorton surnaturel de la société, une reprise par le peuple, pour le peuple, de sa propre vie sociale. Ce n’était pas une révolution pour transférer le pouvoir d’une fraction de la classe dirigeante à une autre, mais une révolution pour détruire la machine même de la domination de classe… Le Second Empire en était la négation définitive, et donc le commencement de la révolution sociale du XIXe siècle. »
L’accent mis par Marx sur l’autogouvernement local est encore confirmé par une anecdote : Bakounine demanda un jour : « Les Allemands sont environ quarante millions. Est-ce que, par exemple, les quarante millions seront membres du gouvernement ? » Marx répondit dans ses notes : « Bien sûr ! Puisque tout commence par l’autogouvernement de la commune. »
Engels confirma également cette orientation en proposant comme point du programme du parti social-démocrate allemand :
« L’autogouvernement complet dans les provinces, districts et communes, par des fonctionnaires élus au suffrage universel. L’abolition de toutes les autorités locales et provinciales nommées par l’État. »
Ainsi, si l’on adopte la définition de l’État de Max Weber, souvent utilisée par les anarchistes – l’État comme monopole de la violence sur un territoire donné – alors la dictature du prolétariat ne serait pas vraiment un État. Mais selon la définition marxiste – l’État comme moyen par lequel une classe exerce son pouvoir sur une autre – elle en serait un. Une grande partie de la confusion dans le débat entre marxistes et anarchistes sur la question de l’État vient de ces définitions différentes.
En vérité, le modèle de socialisme étatique dont on accuse souvent Marx est en réalité beaucoup plus proche de celui du politicien allemand Ferdinand Lassalle, autre grande figure du socialisme allemand au XIXe siècle. Lassalle croyait que le socialisme passait par le contrôle de l’État, et Marx était en profond désaccord avec lui sur ce point. La Critique du programme de Gotha, que j’ai déjà mentionnée, fut en réalité une critique du programme du Parti ouvrier social-démocrate d’Allemagne, fortement influencé par Lassalle. Marx y écrivait :
« … tout le programme, malgré son ton démocratique, est entaché de part en part par la croyance servile de la secte lassalléenne dans l’État, ou – ce qui n’est pas mieux – par une croyance démocratique aux miracles ; ou plutôt c’est un compromis entre ces deux croyances aux miracles, également éloignées du socialisme. »
Lénine
Tout cela se trouve déjà chez Marx, mais au cas où quelqu’un m’accuserait de donner une interprétation de Marx qui serait en réalité une déviation ou une mauvaise lecture anarchiste, il faut préciser que Lénine est d’accord avec tout ce que je viens de dire.
Tout d’abord, il est d’accord avec Marx sur le fait qu’entre le capitalisme et la phase inférieure du communisme, ou socialisme, il existe une période de transition. Il rend cette distinction claire jusque dans la table des matières de L’État et la révolution, où la période de transition est nettement séparée de la phase inférieure du communisme. Dans le texte L’époque de la dictature du prolétariat, il distingue clairement le socialisme de la période de transition, ou dictature du prolétariat, comme je l’ai fait plus haut :
« Le socialisme signifie l’abolition des classes. La dictature du prolétariat a fait tout ce qu’elle pouvait pour abolir les classes. Mais les classes ne peuvent pas être abolies d’un seul coup. Et les classes subsistent et subsisteront encore à l’époque de la dictature du prolétariat. La dictature deviendra inutile quand les classes disparaîtront. »
Le fait que Lénine dise ici que « le socialisme signifie l’abolition des classes » éclaire plusieurs points.
- Il distingue le socialisme de la période de transition, c’est-à-dire de la dictature du prolétariat. En effet, si la dictature du prolétariat est le pouvoir de la classe ouvrière, et que le socialisme est l’abolition des classes, les deux ne peuvent pas être identiques.
- Par implication, le socialisme est sans État. On peut le montrer par un petit raisonnement logique :
- Proposition 1 : Selon Lénine, le socialisme est l’abolition des classes.
- Proposition 2 : Lénine accepte la définition marxiste de l’État, qui le voit comme un instrument de domination de classe, et qui présuppose donc l’existence de classes.
- Conclusion : Si les deux propositions sont vraies, alors, selon Lénine, le socialisme est sans État.
Mais alors, peut-on demander, Lénine ne considérait-il pas la République soviétique comme socialiste ? Et cela ne contredirait-il pas ce qui précède, puisqu’elle avait encore de la monnaie et un État ?
Non, en réalité Lénine ne considérait pas que la République soviétique avait instauré le mode de production socialiste. Bien au contraire. Dans un discours devant le congrès russe, il déclara :
« Nous sommes loin d’avoir achevé même la période de transition du capitalisme au socialisme. Nous n’avons jamais nourri l’espoir de pouvoir la terminer sans l’aide du prolétariat international. Nous n’avons jamais eu d’illusions à ce sujet, et nous savons combien est difficile le chemin qui mène du capitalisme au socialisme. Mais il est de notre devoir de dire que notre République soviétique est une république socialiste parce que nous avons pris cette voie, et nos paroles ne seront pas de vaines paroles. »
En d’autres termes, la République soviétique, tout comme la Commune de Paris, fut qualifiée de « socialiste » non pas parce qu’elle avait établi le mode de production socialiste, mais parce qu’elle se trouvait dans la période de transition vers celui-ci.
Cela est confirmé dans le texte de Lénine L’impôt en nature :
« Personne, je crois, en étudiant la question du système économique de la Russie, n’a nié son caractère transitoire. Aucun communiste, je pense, n’a non plus nié que l’expression République soviétique socialiste implique la volonté du pouvoir soviétique de réaliser la transition vers le socialisme, et non pas que le nouveau système économique soit reconnu comme un ordre socialiste. »
Oh Lénine, tu étais bien optimiste en écrivant cela…
Donc, Lénine était d’accord avec Marx sur l’existence d’une période de transition, et il croyait que la République soviétique se trouvait dans cette période. Qu’en est-il de sa vision de ce à quoi ressemblerait la dictature du prolétariat ? Là encore, il y a un accord complet sur l’essentiel. Lénine pensait que la dictature du prolétariat impliquerait l’abolition de l’armée permanente, de la police et de la bureaucratie, remplacées par une démocratie radicale. Il écrivait :
« … à un certain stade du développement de la démocratie, celle-ci unit d’abord la classe qui mène une lutte révolutionnaire contre le capitalisme – le prolétariat – et lui permet d’écraser, de réduire en miettes, de balayer de la surface de la terre l’État bourgeois, même l’État bourgeois républicain, la machine d’État, l’armée permanente, la police et la bureaucratie, et de les remplacer par une machine d’État plus démocratique, mais qui reste néanmoins une machine d’État, sous la forme d’ouvriers armés qui forment une milice englobant toute la population. »
De plus, il cite, en pleine adhésion, tous les passages de Marx et Engels qui insistent sur l’autogouvernement local.
L’Union soviétique
Mais, étant donné tout cela, pourquoi ce récit a-t-il été éclipsé par celui présenté au début ? La démarche marxiste serait d’examiner quelles conditions matérielles et historiques ont conduit à l’abandon de la vision marxiste originale. À mon avis, l’une des principales raisons fut l’échec de la révolution en Europe, en particulier en Allemagne. Comme le disait Lénine dans la citation mentionnée précédemment :
« Nous n’avons jamais nourri l’espoir de pouvoir la terminer sans l’aide du prolétariat international.
Dès le départ, Marx soulignait que la révolution devait être internationale. Le capitalisme est un système international et doit donc être combattu à l’échelle internationale. Si une révolution survient dans un seul pays, elle sera isolée, et la seule façon pour elle de survivre sera de faire des compromis et des accords commerciaux avec les pays capitalistes. Pour se maintenir, elle devra donc maintenir la production de marchandises, la production pour le profit, et ne pourra jamais sortir du capitalisme.
Par exemple, Engels écrivait :
« Cette révolution pourra-t-elle avoir lieu dans un seul pays ? Non. En créant le marché mondial, la grande industrie a déjà mis tous les peuples de la Terre … en relations si étroites les uns avec les autres qu’aucun n’est indépendant de ce qui arrive aux autres. … Il s’ensuit que la révolution communiste ne sera pas seulement un phénomène national mais devra se produire simultanément dans tous les pays civilisés … C’est une révolution universelle et elle aura, par conséquent, une portée universelle. »
Cela est particulièrement significatif pour la Russie, qui n’était alors pas encore un pays pleinement industrialisé, et où une grande partie de la population était constituée de paysans féodaux. Dans de telles conditions, établir le socialisme est d’autant plus difficile. La doctrine soviétique était à ce moment conforme à Marx et Engels, qui écrivaient en 1882 :
« Si la révolution russe devient le signal d’une révolution prolétarienne en Occident, de sorte que les deux se complètent, la propriété collective actuelle des terres en Russie pourra servir de point de départ pour un développement communiste. »
Le plan initial consistait donc à maintenir la Russie sous contrôle ouvrier, jusqu’à ce que la révolution en Occident se produise et rende le socialisme possible en Russie. Cela était prévu, car une révolution ouvrière se déroulait en Allemagne entre 1917 et 1919, et des mouvements révolutionnaires apparaissaient dans le monde entier. À ce moment, une grande partie de la politique soviétique consistait à soutenir ces mouvements révolutionnaires sur le plan politique et économique.
Cependant, la révolution allemande échoua, trahie par le Parti social-démocrate allemand, qui utilisa le groupe paramilitaire proto-fasciste des Freikorps pour exécuter les leaders révolutionnaires Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, ouvrant ainsi la voie à la montée du fascisme. De plus, la guerre civile coûta aux bolcheviks presque toute leur base ouvrière. En 1921, la plupart des travailleurs industriels étaient soit partis combattre dans l’Armée rouge, soit retournés à la terre. Cela amena même Lénine à dire :
« Nous sommes les représentants d’une classe qui a cessé d’exister. »
Dans ces conditions, la bureaucratie se gonfla tellement que, dans ses derniers mots au Parti communiste, Lénine déclara :
« Si nous prenons Moscou avec ses 4 700 communistes occupant des postes de responsabilité, et si nous prenons cette énorme machine bureaucratique, ce gigantesque amas, il faut se demander : qui dirige qui ? Je doute fort qu’on puisse dire avec vérité que les communistes dirigent cet amas. À dire vrai, ils ne dirigent pas, ils sont dirigés. »
Face à cette situation, l’Union soviétique devint isolée et bureaucratisée, confrontée à des conditions extrêmement difficiles sans que ce soit de sa faute. Je ne doute pas des bonnes intentions de la direction soviétique, qui voulait véritablement instaurer le socialisme, mais la situation de classe en Russie et dans le monde rendait cela impossible, et le parti se retrouva bloqué, incapable d’avancer. Ayant perdu sa base prolétarienne, le parti passa d’une organisation révolutionnaire à des représentants d’une société capitaliste, devenant de facto des sociaux-démocrates – des superviseurs étatiques d’une économie de marché.
Certains dirigeants soviétiques avaient proposé de développer progressivement les forces de production tout en continuant à soutenir le mouvement communiste international et à attendre son succès. Cependant, la solution qui l’emporta fut d’abandonner le projet international pour se concentrer sur la construction de l’État-nation, consolidée ensuite dans la conception de Staline du « socialisme dans un seul pays » – ce que Marx aurait considéré comme une impossibilité absolue.
Le passage de l’internationalisme au nationalisme est clairement exprimé si l’on examine Les Fondements du léninisme de Staline en 1924. Dans l’édition originale, les vues de Lénine y étaient fidèlement reflétées :
« Le renversement du pouvoir de la bourgeoisie et l’établissement d’un gouvernement prolétarien dans un seul pays ne garantissent pas encore la victoire complète du socialisme. La tâche principale du socialisme, l’organisation de la production socialiste, reste à accomplir. Cette tâche peut-elle être réalisée, la victoire du socialisme dans un seul pays peut-elle être atteinte, sans les efforts conjoints du prolétariat de plusieurs pays avancés ? Non, c’est impossible … Pour la victoire finale du socialisme, pour l’organisation de la production socialiste, les efforts d’un seul pays, particulièrement d’un pays paysan comme la Russie, sont insuffisants. »
Pourtant, quelques mois plus tard, cette édition fut retirée et remplacée par une nouvelle affirmant exactement le contraire :
« Après avoir consolidé son pouvoir et entraîné les paysans dans son sillage, le prolétariat du pays victorieux peut et doit construire une société socialiste… »
Parce que l’État soviétique devait encore se légitimer, la doctrine officielle changea progressivement et la dictature du prolétariat fut confondue avec le socialisme. Les débats animés entre économistes soviétiques sur l’abolition de l’argent cessèrent, et la direction s’attendit de moins en moins à sortir du capitalisme. L’URSS fut qualifiée de socialiste malgré l’absence de critères définis par Marx ou Lénine. À ce moment, l’URSS n’était plus un État ouvrier selon aucun critère : les conseils ouvriers et milices ouvrières, partout où ils existaient, n’avaient plus aucun pouvoir, l’État brisait les grèves et censurait même certaines publications de Marx, refusant la diffusion complète de ses œuvres.
Désormais, au lieu de soutenir les mouvements révolutionnaires, l’URSS soutint de plus en plus les mouvements nationalistes, au détriment des révolutionnaires. Par exemple, le Komintern, contrôlé par les Soviétiques, soutint le parti nationaliste chinois. Le politicien nationaliste chinois Chiang Kai-shek devint membre honoraire du Komintern. Dans les années 1920, les communistes chinois avaient tenté une révolution, mais le Komintern les arrêta et les ordonna de s’allier au parti nationaliste chinois, ce qui conduisit au désarmement des communistes chinois et, en 1927, le parti nationaliste massacra des milliers d’entre eux. En d’autres termes, cet événement ne montrait pas l’échec du marxisme, mais le succès d’une contre-révolution contre le marxisme.
Marx avait consacré tant de ses forces théoriques pour combattre le courant lassallien du socialisme, cette « croyance servile dans l’État », comme il disait, et cela mérite le respect, non pas parce que cela vient de Marx, mais parce que cela reflète les luttes des classes ouvrières du monde entier depuis l’aube du capitalisme – ce sont elles les véritables moteurs de l’histoire. Comme le disait Engels :
« L’idée que les actes politiques, les grandes performances de l’État, sont décisifs dans l’histoire est aussi ancienne que l’histoire écrite elle-même, et c’est la principale raison pour laquelle si peu de matériaux nous ont été conservés concernant l’évolution réellement progressive des peuples, qui a eu lieu discrètement, en arrière-plan, derrière ces scènes bruyantes sur la scène. »
Œuvres citées
Karl Marx & Friedrich Engels — Le Manifeste du Parti communiste — marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf
Karl Marx — Critique de la philosophie du droit de Hegel — marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Critique_of_Hegels_Philosophy_of_Right.pdf
Karl Marx — Critique du programme de Gotha — marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Critque_of_the_Gotha_Programme.pdf
Karl Marx — La Guerre civile en France — marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/civil_war_france.pdf
Karl Marx — Conspectus des notes de Bakounine sur Étatisme et anarchie — marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm
Friedrich Engels — Critique du projet de programme social-démocrate de 1891 — marxists.catbull.com/archive/marx/works/1891/06/29.htm
Vladimir Lénine — L’État et la révolution — marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/
Vladimir Lénine — Économie et politique à l’époque de la dictature du prolétariat — marxists.org/archive/lenin/works/1919/oct/30.htm
Vladimir Lénine — Troisième congrès panrusse des soviets des députés ouvriers, soldats et paysans — marxists.org/archive/lenin/works/1918/jan/10.htm
Vladimir Lénine — L’impôt en nature — marxists.org/archive/lenin/works/1921/apr/21.htm
Friedrich Engels — Les Principes du communisme — marxists.org/archive/marx/works/1847/11/prin-com.htm
Vladimir Lénine — Onzième congrès du P.C.(b) de Russie — marxists.org/archive/lenin/works/1922/mar/27.htm#fw01
Joseph Staline — Les Fondements du léninisme — marxists.org/reference/archive/stalin/works/1924/foundations-leninism/index.htm
Friedrich Engels — Anti-Dühring — marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/
Œuvres recommandées
Karl Marx — Critique du programme de Gotha — marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Critque_of_the_Gotha_Programme.pdf
Vladimir Lénine — L’État et la révolution — marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/
Simon Pirani — The Russian Revolution in Retreat — libcom.org/files/[Simon_Pirani]The_Russian_Revolution_in_Retreat,(b-ok.org).pdf
Victor Serge — Mémoires d’un révolutionnaire — my-blackout.com/wp-content/uploads/2018/07/webpage2.pdf
Sur la révolution chinoise de 1925 : libcom.org/history/chinese-revolution-1925-1927
Note
Dans certains de ses écrits ultérieurs, Lénine commence effectivement à confondre la dictature du prolétariat, en contradiction avec Marx et avec ses propres écrits antérieurs. Il y a trois raisons possibles à cela :
- À mesure que son parti devient moins révolutionnaire, il est peut-être déjà en train de légitimer l’État comme socialiste, ce qui culmine avec Staline.
- Sa santé déclinante peut l’avoir conduit à être moins rigoureux dans l’usage de sa terminologie.
- Il utilise le terme « socialisme » dans un autre sens, celui de la tendance socialiste.

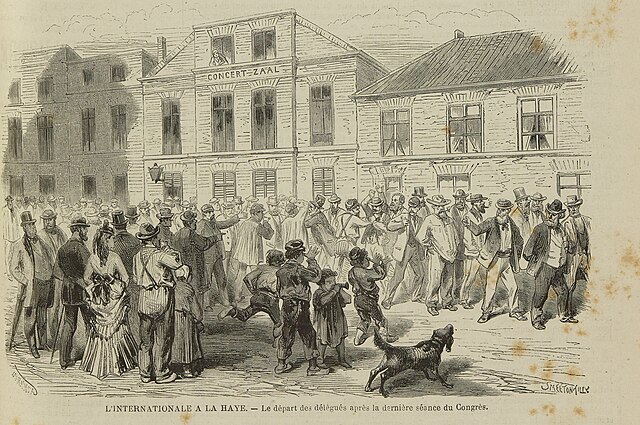
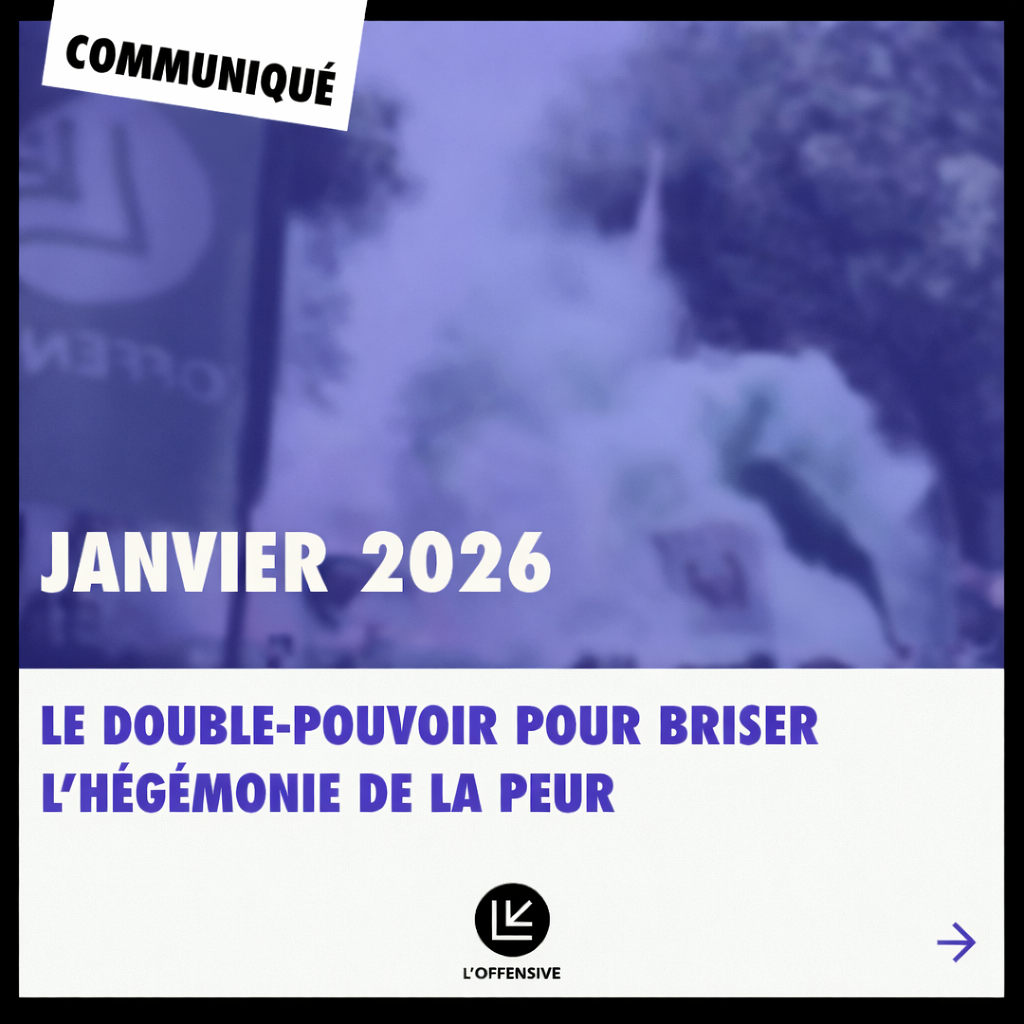



Laisser un commentaire