
Certaines métaphores utilisées pour représenter les enjeux écologiques jouent un rôle bien plus politique qu’il n’y paraît. En particulier, elles peuvent servir de passerelle idéologique entre un conservatisme traditionnel et des formes d’écofascisme assumé. Dans ce texte, le collectif Out of the Woods analyse comment certaines idées issues de l’écologie ont été mobilisées pour justifier des politiques autoritaires, racistes ou élitistes. Pour cela, ils proposent une lecture critique de la pensée de Garrett Hardin, biologiste connu pour sa métaphore de « la tragédie des communs », souvent citée dans les débats environnementaux, mais rarement remise en question.
La tragédie du capital
Le concept le plus célèbre et influent de Hardin est celui de la tragédie des communs, un problème d’action collective censé conduire inévitablement à la ruine de toutes les ressources communes. Il a d’abord exposé ce problème dans son essai de 1968 portant ce titre :
« La tragédie des communs se développe ainsi. Imaginons un pâturage ouvert à tous. On peut s’attendre à ce que chaque berger essaie d’y mettre autant de bétail que possible. (…) En tant qu’être rationnel, chaque berger cherche à maximiser son profit. Explicitement ou implicitement, plus ou moins consciemment, il se demande : “Quel est l’intérêt pour moi d’ajouter un animal de plus à mon troupeau ?” (…) Le berger rationnel conclut que la seule démarche sensée est d’ajouter un autre animal à son troupeau. Et encore un autre ; et encore un autre… Mais c’est la conclusion à laquelle arrive chaque berger partageant ce bien commun. Voilà la tragédie. Chaque homme est enfermé dans un système qui l’oblige à accroître son troupeau sans limite — dans un monde limité. La ruine est la destination vers laquelle tous se précipitent, chacun poursuivant son propre intérêt dans une société qui croit en la liberté des communs. La liberté dans un bien commun conduit à la ruine de tous. »
De nombreuses critiques sont possibles ici. D’abord, bien que l’essai ait été publié dans la revue Science, Hardin ne présente aucune preuve concrète, seulement une expérience de pensée. En 1990, Elinor Ostrom a publié Governing the Commons (La gouvernance des communs), un ouvrage qui lui a valu le prix Nobel d’économie, où elle démontre que les communs ne mènent pas forcément à une ruine mutuelle. Par la suite, Hardin a reconnu que son argument ne s’appliquait qu’aux communs non gérés, ce qui en réduit considérablement la portée. Pourtant, la tragédie des communs reste un pilier de l’éthique environnementale et de l’économie écologique. Elle est encore souvent citée sans critique dans les manuels d’introduction aux sciences du climat.
Plus fondamentalement, l’argument de Hardin suppose les mêmes relations sociales qu’il présente comme devant être corrigées. Hardin part du principe que chaque berger cherche à posséder autant de bétail que possible. Ces bergers ne sont donc pas des producteurs de subsistance, qui élèveraient du bétail pour leur propre consommation, mais produisent pour autrui. En outre, chacun le fait de manière concurrentielle : ces bergers produisent des marchandises destinées au marché. Ce sont des agents rationnels qui cherchent à maximiser leur utilité, sans liens sociaux, ni normes, ni relations entre eux, malgré le fait qu’ils partagent un pâturage commun. Enfin, pour qu’il y ait un marché capable d’absorber un nombre toujours croissant de bovins, cela implique que d’autres, ailleurs, n’ont pas accès à leurs propres communs pour se fournir en bétail. Autrement dit, la situation décrite par Hardin suppose l’existence d’un commun isolé dans un océan d’enclosures.
En résumé, Hardin suppose une production concurrentielle pour le marché, dans des conditions d’échange généralisé de marchandises et d’enclosure, effectuée par des agents rationnels cherchant à maximiser leur utilité. Autrement dit, il suppose les relations historiquement spécifiques du capitalisme — relations qui n’ont été établies qu’après l’enclosure et la privatisation généralisée des communs. La tragédie de Hardin devrait plutôt être appelée la tragédie du capital, car elle ne montre que comment les relations capitalistes de production concurrentielle, sans limite, pour le marché tendent à détruire leurs propres conditions d’existence. Ainsi, l’argument de Hardin est historiquement faux, théoriquement circulaire et empiriquement douteux. Pourtant, il joue toujours un rôle idéologique important en justifiant davantage de privatisations, d’enclosures et de concurrence marchande… comme solution aux problèmes causés par la privatisation, l’enclosure et la concurrence marchande.
La population n’est pas le problème
Bien qu’il ait influencé l’économie écologique, la préoccupation principale de Hardin tout au long de son œuvre était la croissance démographique, contre laquelle il a promu l’eugénisme. Dans son texte de 1968, il déclarait que « la liberté de se reproduire est intolérable » et posait la question :
« Comment devons-nous traiter la famille, la religion, la race ou la classe (ou tout autre groupe identifiable et cohésif) qui adopte la sur-reproduction comme politique pour assurer sa propre grandeur ? »
Sa réponse était la coercition :
« La coercition est un mot sale pour la plupart des libéraux aujourd’hui, mais il ne doit pas le rester pour toujours. Comme pour les mots de quatre lettres, sa saleté peut être lavée par l’exposition à la lumière, en le répétant encore et encore sans excuses ni gêne. »
Hardin cite Thomas Malthus, le moraliste et révérend du XVIIIe siècle, mais peu de sources contemporaines en démographie. Malthus affirmait que la population augmenterait de manière exponentielle, alors que la production alimentaire ne croîtrait que de manière linéaire. Cela rendrait la faim et la misère des caractéristiques permanentes et insolubles de la société humaine, puisque la population dépasserait toujours les ressources disponibles. Hardin a obtenu un doctorat en microbiologie. Les études de population bactérienne font partie de la formation de base de tout microbiologiste. En effet, les bactéries se reproduisent presque exponentiellement, doublant leur nombre à chaque génération, jusqu’à ce que leur croissance soit freinée par un facteur limitant, comme l’épuisement des nutriments.
Hardin semble s’appuyer sur le récit moral de Malthus et le « bon sens » du microbiologiste, sans même vérifier si les populations humaines croissent réellement jusqu’à être stoppées par la famine. Heureusement, ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, les pays où la population est stable ou en déclin ne sont pas ceux où sévit la famine — et les pays touchés par des famines ont souvent une population en croissance. De plus, comme l’a démontré Amartya Sen, les famines récentes ne sont pas causées par un manque de nourriture, mais par un manque de pouvoir d’achat pour acheter cette nourriture. Plutôt que de croître de manière exponentielle jusqu’à être freinée par la famine, comme les bactéries, la population humaine tend à suivre une courbe sigmoïde (en forme de S).
Une population humaine est stable lorsque le taux de natalité est égal au taux de mortalité. Si la stabilisation de la population était causée par la famine, cela signifierait que le taux de mortalité augmente jusqu’à égaler le taux de natalité. En réalité, les deux diminuent. Avant la médecine moderne, les taux de natalité et de mortalité étaient élevés, les villes étaient des foyers de maladies (des « puits » démographiques), et la population était donc jeune et rurale. Avec l’apparition des connaissances modernes sur les maladies, une série de changements ont conduit à la baisse des taux de mortalité, puis des taux de natalité, à l’urbanisation, et à un vieillissement de la population. Ce phénomène est appelé transition démographique.
La croissance apparemment exponentielle observée par Malthus était en réalité la phase de transition entre un équilibre à forte natalité/mortalité et un équilibre à faible natalité/mortalité. Cette transition semble suivre un schéma plus ou moins universel, générant une série de rétroactions positives une fois qu’elle commence.
Les pays les plus développés ont entamé cette transition il y a plusieurs siècles et sont aujourd’hui pour la plupart arrivés à un équilibre urbain, plus âgé, voire à un déclin démographique (ce qui est devenu une préoccupation dans certains pays). De nombreux pays moins développés n’ont pas encore atteint cet équilibre supérieur, ont des populations plus jeunes, plus rurales, et connaissent encore une forte croissance démographique. Les démographes de l’ONU prévoient que la population mondiale se stabilisera autour de 9 milliards d’individus.
En 1798, Malthus avait donc pris à tort la phase de croissance rapide d’une courbe sigmoïde pour une croissance exponentielle. En réalité, Malthus ne cherchait pas tant à développer une théorie écologique humaine qu’à attaquer politiquement les lois sur les pauvres et l’idée d’augmenter les salaires des travailleurs.
Hardin, qui a réaffirmé sa thèse encore en 1998, est au moins aussi conservateur que Malthus, mais probablement moins intelligent ou moins honnête intellectuellement. Une fois encore, les preuves manquent cruellement pour appuyer son affirmation centrale, et en 200 ans, de nombreuses preuves contraires ont été accumulées.
L’éthique du canot de sauvetage
Les supposés problèmes de la tragédie des communs et de la croissance exponentielle de la population ont conduit Hardin à développer une théorie morale très influente : l’éthique du canot de sauvetage. Sa métaphore est choisie pour s’opposer à celle, plus progressiste, des écologistes qui parlent de « vaisseau spatial Terre ». Hardin fait remarquer qu’il n’existe pas de gouvernement mondial, et qu’on ne peut pas avoir un vaisseau spatial sans capitaine (apparemment). Pour lui, chaque nation est donc un canot de sauvetage. Les immigrants voudraient y monter, surpasser les habitants en nombre, et détruire la civilisation. Le sous-titre de son essai était d’ailleurs : le cas contre l’aide aux pauvres. Le sous-texte raciste et patriarcal y est à peine dissimulé.
Une fois sa métaphore posée, Hardin raisonne comme si les États-nations étaient réellement des canots de sauvetage bondés, et non, par exemple, de vastes territoires couvrant un tiers de la surface terrestre. La prémisse majeure de son argument est encore une fois la croissance malthusienne de la population ; la prémisse mineure, la tragédie des communs. Or, puisque ces deux idées ne résistent pas à l’analyse, son argumentation en faveur de l’éthique du canot de sauvetage s’effondre. Mais la réaction politique ne repose pas sur la raison, et la métaphore du canot de sauvetage assiégé a pris ses quartiers dans l’ensemble du discours politique dominant :
C’est une vieille rengaine — « nous manquons de place, il y a déjà trop de gens ici, les ressources sont rares ». Ce discours ne se limite pas à la droite ou l’extrême droite : c’est aussi la “logique” de tous les partis majeurs.
Hardin se présente comme un réaliste sobre, celui qui a le courage de dire les choses désagréables : fermez les frontières, stérilisez les reproducteurs irresponsables, laissez la famine dépeupler l’Afrique (et gardez les plages propres !). Mais attention, dit-il, ne tuez pas le messager, il ne fait que dire les choses telles qu’elles sont.
C’est pourtant un drôle de « réaliste » que celui qui suppose que la société humaine fonctionne comme une colonie de bactéries sans jamais vérifier — d’autant plus quand cette analogie mène à des conséquences proches du génocide. Il s’agit là d’un cas précoce de ce que l’on connaît bien aujourd’hui : le faux réalisme du « il n’y a pas d’alternative », qui cherche à mettre hors de portée de la critique une politique réactionnaire en invoquant une prétendue « réalité » — réalité qui repose en fait sur des expériences de pensée sans preuve.
La réaction anthropocène
Hardin est souvent, et à juste titre, considéré comme essentiellement fasciste, invoquant des limites écologiques pour promouvoir une politique eugéniste hostile à l’immigration et au droit des femmes à disposer de leur corps. Mais Hardin est-il fasciste ? Ce qui semble manquer dans son discours, c’est l’ultranationalisme palinégénésique — c’est-à-dire l’idée d’une renaissance radicale de la nation. L’eugénisme et l’hostilité à l’immigration sont des points communs entre conservateurs et fascistes. Churchill autant qu’Hitler ont soutenu l’eugénisme, le nationalisme et l’empire.
Hardin, cependant, adopte plutôt la résignation blasée du conservatisme « réaliste » de la guerre froide (« ce n’est pas idéal, mais c’est le moins pire »), plutôt que l’ultranationalisme de renaissance prôné par les fascistes. Hardin est satisfait de rester sur son canot de sauvetage, tant que ceux qui sont à l’eau restent à leur place. Le fasciste, lui, promet de relever l’épave, de lui rendre sa gloire passée et de la faire voguer à nouveau — à condition de jeter d’abord par-dessus bord les poids morts.
Mais cela ne considère le fascisme qu’au niveau macropolitique, celui de la nation. Or :
« Ce qui rend le fascisme dangereux, c’est son pouvoir moléculaire ou micropolitique, car c’est un mouvement de masse : un corps cancéreux plutôt qu’un organisme totalitaire. »
Le désir de Hardin de « purifier » la coercition en la répétant sans gêne trouve aujourd’hui un écho dans un mème particulièrement toxique : la nostalgie de l’austérité. Son « éthique du canot de sauvetage » n’est pas du tout marginale ou réservée à l’extrême droite – et c’est justement ce qui la rend si dangereuse.
C’est pourquoi Deleuze et Guattari écrivent que :
« La devise des politiques domestiques pourrait être : une macropolitique de société au service d’une micropolitique de l’insécurité. »
La population est liée à l’État par une production constante d’insécurité et d’anxiété : les musulmans terroristes, les assistés fainéants — et bien sûr, les immigrés qui submergent notre précieux canot national. Ces épouvantails sont peut-être des fantômes, mais l’insécurité qu’ils produisent est bien réelle. Les récents succès de l’extrême droite en Europe exploitent ce phénomène, mais ne l’ont pas créé.
La droite réactionnaire, comme celle du UKIP (au Royaume-Uni), a jusqu’à présent adopté le déni du changement climatique (et le financement des énergies fossiles qui va avec). Ce n’est peut-être pas une mauvaise chose : veut-on vraiment voir le populisme du UKIP fusionner avec l’écologie réactionnaire de Hardin ?
Le mythe du “Blitz spirit” (esprit de résistance britannique pendant la guerre) montre comment les communautés face aux catastrophes peuvent être nationalement reconfigurées — vues comme une renaissance de ce qui « fait la grandeur de la Grande-Bretagne ». L’éthique du canot de sauvetage et la nostalgie de l’austérité forment déjà un mélange toxique qui imprègne profondément la politique officielle.
L’écologie lugubre de Hardin constitue donc la première ébauche de la politique de la réaction anthropocène. Et à mesure que le climat se dégrade, il y a fort à parier que nous verrons apparaître de nouvelles versions de cette politique réactionnaire, venant de tout l’éventail politique.

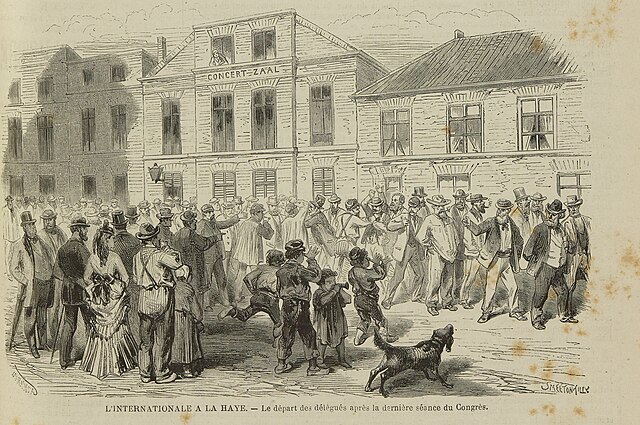
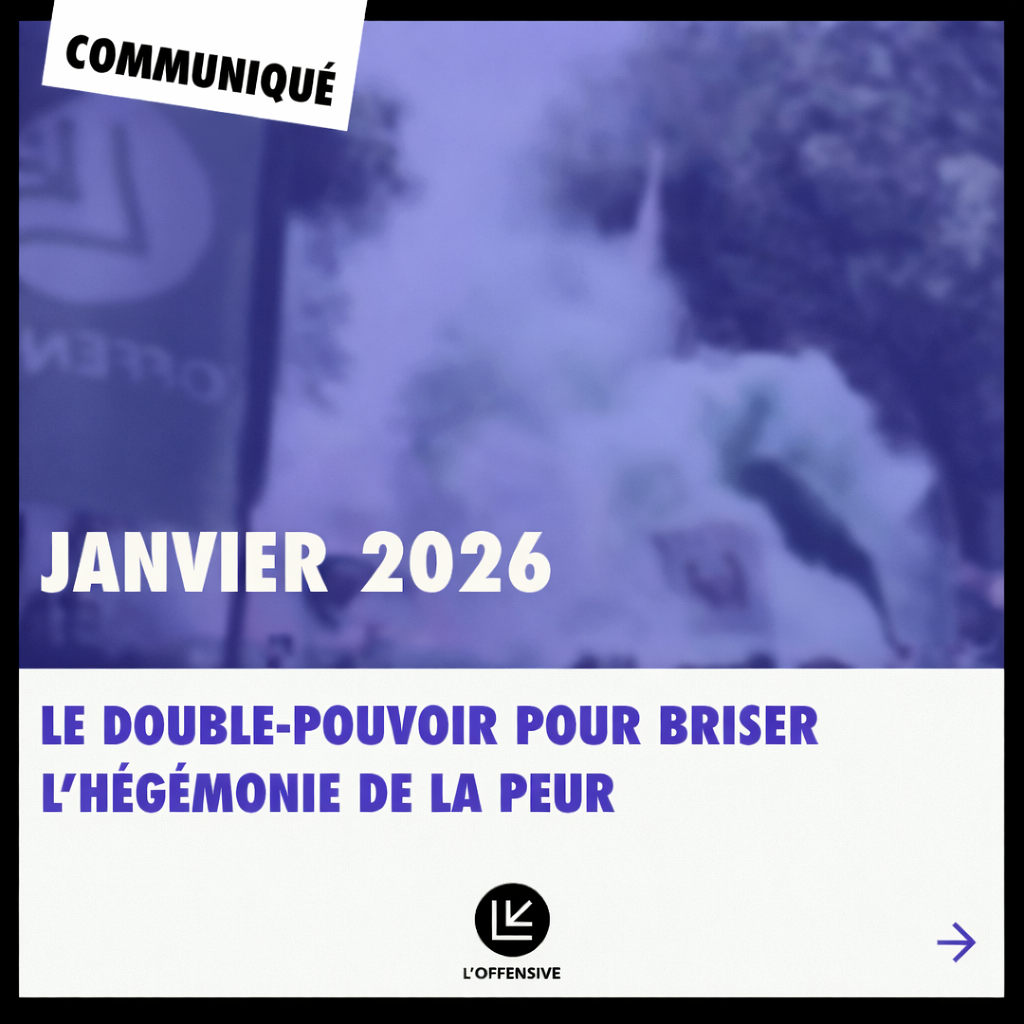



Laisser un commentaire