
Au moment où des mouvements sociaux montent un peu partout en Europe et dans le reste du monde, et que quelques-uns exercent un pouvoir de plus en plus absolu sur la majorité des citoyens, une question revient avec insistance : la forme du pouvoir qui permettra l’émancipation des classes populaires du capitalisme et de l’État-nation. Telle est la longue querelle que se livrent depuis des décennies les courants marxistes et ceux plus libertaires, sur l’État, les formes d’auto-organisation et sur la nécessité de structures alternatives aux institutions capitalistes. Les crispations se concentrent en particulier sur un concept marxiste : celui de la dictature du prolétariat. Certains y voient un outil d’émancipation, d’autres un nouvel outil d’asservissement. Si les contours de la dictature du prolétariat sont parfois flous, mal définis par Karl Marx et différents en termes d’interprétation selon les courants de pensée, le concept a surtout servi à justifier une véritable dictature bureaucratique dans les pays se réclamant du communisme, jetant un certain discrédit sur le terme et donnant partiellement raison aux tendances les plus anarchistes dans leur critique de la dictature du prolétariat. Alors, faut-il donner une seconde chance à ce concept ?
S’il y a bien un concept qui fait débat parmi la gauche radicale, c’est celui de la dictature du prolétariat. Ce terme de « dictature du prolétariat » trouve son origine dans la pensée de Karl Marx, qui l’utilise pour la première fois en 1852, dans une lettre adressée à Joseph Weydemeyer. Marx y affirme que la lutte des classes aboutit nécessairement à la prise du pouvoir politique par le prolétariat, étape transitoire indispensable pour abolir les rapports de production capitalistes et instaurer une société sans classes. Toutefois, l’idée, en tant que telle, apparaît dès 1848, notamment dans les articles de Marx sur les luttes de classes en France, où il évoque la nécessité pour la classe ouvrière de s’imposer comme force dirigeante après la révolution. Le terme est ensuite précisé dans la Critique du programme de Gotha (1875), où Marx décrit cette « dictature » comme une forme temporaire de pouvoir collectif de la classe ouvrière, et non une dictature individuelle, destinée à conduire à l’abolition de l’État et des classes sociales.
Malgré tout, Karl Marx n’a jamais vraiment développé plus en profondeur ce concept, restant principalement en surface. Il ne fournit pas une théorisation précise de la nature de la « dictature du prolétariat », laissant ouverte la question de savoir s’il s’agit d’un État ou d’une forme nouvelle de pouvoir transitoire. Pour rappel, chez Marx, l’État est avant tout un instrument d’oppression d’une classe par une autre, et le pouvoir prolétarien doit mener à l’extinction progressive de tout appareil d’État. Il décrit peu les structures concrètes de ce pouvoir révolutionnaire, se contentant d’affirmer son rôle transitoire vers une société sans classes. Ce flou donnera lieu à des débats ultérieurs, notamment avec Lénine, qui identifiera la dictature du prolétariat à un « État ouvrier » voué à se dissoudre une fois le communisme pleinement réalisé, ce qui se révélera être un bel euphémisme quand on sait la direction prise par l’URSS.
Friedrich Engels, le compagnon de Karl Marx, sera par moments un point moins abstrait, notamment dans l’introduction de 1891 à La Guerre civile en France. Engels écrit :
« Le philistin social-démocrate a été récemment saisi d’une terreur salutaire en entendant prononcer le mot de dictature du prolétariat. Eh bien, messieurs, voulez-vous savoir de quoi cette dictature a l’air ? Regardez la Commune de Paris. C’était la dictature du prolétariat. […] En réalité, l’État n’est rien d’autre qu’un appareil pour opprimer une classe par une autre, et cela, tout autant dans la république démocratique que dans la monarchie ; le moins qu’on puisse en dire, c’est qu’il est un mal dont hérite le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe et dont, tout comme la Commune, il ne pourra s’empêcher de rogner aussitôt au maximum les côtés les plus nuisibles, jusqu’à ce qu’une génération grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres soit en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l’État. »
Friedrich Engels souligne également que la Commune a adopté des mesures révolutionnaires, notamment :
- Tous les postes officiels étaient pourvus par des élections démocratiques, avec un droit de révocation immédiat des élus.
- Les fonctionnaires percevaient un salaire équivalent à celui d’un ouvrier, supprimant ainsi tout privilège bureaucratique.
Il est à partir de ces éléments évident que la dictature du prolétariat n’est pas une dictature personnelle exercée par un ou plusieurs individus au nom de cette même classe, mais bien une forme de démocratie « ouvrière ». Comme l’écrit Julius Martov dans Dictatorship and Democracy (1919–1920) :
« En 1848, Engels et Marx identifièrent l’acte d’élever le prolétariat à une classe dirigeante à la conquête de la démocratie. Pour eux, la dictature du prolétariat ne signifiait pas l’abolition de la démocratie, mais son accomplissement par le pouvoir politique direct de la majorité laborieuse contre la minorité dominante. »
La Commune était à ce titre une des formes de gouvernement de la classe ouvrière, organisée pour éviter la formation d’une nouvelle classe dominante. Si Engels ne semble pas rejeter le terme d’État dans ce passage et est conscient de ses limites, cet État prend une forme bien différente de l’État bourgeois ou de sa démocratie représentative. En effet, c’est une véritable démocratie directe, exercée directement par et pour les concernés, avec pour seuls mandats des mandats impératifs et révocables, dans un modèle de gouvernance décentralisé et non hiérarchique.
Il convient également de dissiper une confusion fréquente : la dictature du prolétariat n’a pas vocation à se transformer en tyrannie de la majorité. Elle ne consiste pas à imposer arbitrairement la volonté du plus grand nombre sur des minorités sociales ou politiques, mais à abolir la domination d’une minorité possédante sur l’ensemble de la société. Une fois les privilèges économiques et politiques supprimés, personne n’est censé être réduit au silence ou privé de ses droits fondamentaux.
Et en théorie dans cette démocratie ouvrière, chaque individu – y compris ceux qui ne partagent pas les orientations majoritaires – conserve une liberté totale d’expression, d’organisation et d’action politique. Les institutions révolutionnaires, fondées sur des mandats impératifs, révocables et un contrôle permanent de la base, empêchent l’émergence d’un pouvoir arbitraire, même majoritaire.
Si Karl Marx a pu, dans ses premiers écrits révolutionnaires, se concentrer sur la nécessité d’une révolution prolétarienne, son analyse a semblé évoluer après l’expérience de la Commune de Paris en 1871. À partir de cet événement, Marx et Engels perçoivent la Commune comme un exemple concret de pouvoir ouvrier décentralisé, fondé sur des mandats élus et révocables, permettant de limiter les abus bureaucratiques et privilégiant la démocratie directe. Le fait que Karl Marx ne se soit jamais trop étendu sur la nature de la dictature du prolétariat est en réalité volontaire, si l’on se réfère à la maxime « l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Il n’a dans cette optique proposé aucun modèle précis et comptait sans doute sur l’intelligence collective pour inventer de nouvelles formes originales de pouvoir, comme ce fut le cas des communes ou des soviets par la suite.
C’est sur ces bases qu’il faut comprendre la dictature du prolétariat, et non sur celles fallacieuses du marxisme-léninisme, qui l’a détournée au profit de bureaucrates avides de pouvoir, en centralisant tout le pouvoir dans un parti unique et en remplaçant les soviets par un État-parti autoritaire. On devrait même parler de « dictature sur le prolétariat » plutôt que de « dictature du prolétariat », tant l’idée d’origine a été déformée et vidée de sa substance.
La démocratie plénière
L’enjeu aujourd’hui est de se demander si la notion de dictature du prolétariat conserve une pertinence à l’ère de la désindustrialisation dans les pays développés, et face à l’usage courant du terme comme simple synonyme de dictature bureaucratique. Il s’agit de préserver l’idée centrale derrière ce concept – l’émancipation des opprimés et la transformation radicale des rapports de pouvoir – tout en la réactualisant pour une société du XXIᵉ siècle. Dans un contexte où le terme « prolétaire » semble désuet car il renvoie à une époque où la majorité des travailleurs était concentrée dans de grandes usines, sous un salariat relativement homogène, clairement opposé à une bourgeoisie industrielle bien identifiable. Aujourd’hui, cette image ne correspond plus à la réalité : la désindustrialisation a réduit le nombre d’ouvriers dans les pays développés, les formes de travail se sont fragmentées (salariat précaire, indépendants, auto-emploi forcé…), et l’économie de plateforme a remplacé l’usine comme principal lieu d’exploitation. La figure traditionnelle du « travailleur d’usine » n’incarne donc plus à elle seule l’ensemble des dominés par le capitalisme.
D’autant que les luttes sociales dépassent la seule sphère économique pour englober de multiples formes d’oppressions (genre, race, écologie, précarité), une réflexion s’impose pour repenser ce projet sous une forme plus inclusive et adaptée aux réalités contemporaines.
Pour cela, il est nécessaire de revenir à ce que signifiait la dictature du prolétariat dans son sens originel. Marx et Engels l’emploient dans un contexte où les ressources et le pouvoir politique sont accaparés par une minorité – la bourgeoisie – qui impose sa volonté à l’ensemble de la population. Derrière la façade démocratique des institutions libérales, ils dénoncent une véritable dictature bourgeoise, c’est-à-dire le règne des intérêts de cette minorité sur la majorité. La dictature du prolétariat désigne alors le renversement de cette logique : l’exercice du pouvoir politique par la majorité – les travailleurs – pour gouverner dans l’intérêt du plus grand nombre. Il apparaît donc que l’exercice du pouvoir par la majorité ne peut se concevoir que dans le cadre d’une démocratie la plus large possible, impliquant directement le plus grand nombre dans les processus de décision. Cela suppose une forme de démocratie dite « directe », où les individus participent eux-mêmes aux choix qui les concernent, plutôt que de les déléguer entièrement à une élite politique comme c’est le cas de la démocratie représentative.
Si la domination de la bourgeoisie reste une réalité aujourd’hui, Marx et Engels avaient une vision principalement économiciste des rapports de pouvoir, négligeant d’autres formes de hiérarchies sociales. Racisme, patriarcat, bureaucratie… ces systèmes d’oppression sont tout autant des rapports de domination que les classes économiques. On peut parfaitement imaginer une société débarrassée du capitalisme mais perpétuant l’oppression de minorités ou de groupes sociaux relégués au rang de sous-citoyens.
Il est donc impératif de mener la lutte sur plusieurs fronts : la lutte des classes doit aller de pair avec la lutte contre toutes les hiérarchies. La « dictature » ne peut plus être uniquement celle du prolétariat mais bien celle des opprimés dans leur ensemble, unis pour abattre toutes les formes de domination. Cependant, ce terme même de « dictature » trahit mal l’objectif véritable du projet révolutionnaire. Ce que nous visons, ce n’est pas un pouvoir oppressif inversé, mais une démocratie bien plus profonde, une démocratie réelle où la majorité gouverne directement dans son propre intérêt. Comme le signale Julius Martov :
« La dictature du prolétariat ne contredit pas les principes de la démocratie ; au contraire, elle permet leur pleine réalisation : elle implique un gouvernement réellement démocratique, des mandats populaires élus, révocables, un minimum de privilèges pour les fonctionnaires et une liberté illimitée de propagande et d’agitation. »
Si la dictature du prolétariat soulignait initialement l’idée d’une majorité – historiquement les travailleurs – imposant sa volonté à une minorité dominante, il ne faut pas oublier que l’objectif final est la disparition même de cette minorité bourgeoise en tant que classe. Par des mesures révolutionnaires – abolition de l’héritage, confiscation des fortunes, suppression de la monnaie et de tous les instruments de domination – les privilèges bourgeois disparaîtront. Les anciens bourgeois deviendront des semblables, libérés de leur statut de possédants, et pourront participer à l’édification d’une nouvelle société où chacun contribue à l’effort collectif et prend part aux décisions démocratiques.
À terme, ce n’est pas une dictature que nous voulons, mais une « démocratie plénière », qui vise avant tout la participation réelle de tout le monde, tout le temps, sans laisser le pouvoir à une élite ou à des représentants figés. Ça passe par des assemblées populaires horizontales où chacun et chacune peut s’exprimer, décider, et contrôler les mandaté·es, qui restent toujours révocables. Des exemples concrets comme les conseils zapatistes au Chiapas ou les communes du Rojava montrent que c’est possible : un pouvoir partagé, tournant, où tout le monde a vraiment son mot à dire, et où la politique redevient une affaire collective, pas un pouvoir à déléguer une fois pour toutes.
Dans une telle organisation, chaque individu exerce un pouvoir réel sur les affaires qui le concernent, et les décisions collectives se construisent à travers une participation directe, égalitaire et permanente de toutes et tous.– dans sa commune, sur son lieu de travail, à l’université, dans les services publics. La démocratie partout, tout le temps, et non comme un acte séparé de la vie.
La démocratie plénière est un processus mouvant, qui exige de lutter sans relâche contre toutes les formes de domination et de faire disparaître les classes sociales qui faussent toute véritable démocratie horizontale. Ce n’est pas qu’un simple système institutionnel : c’est un chemin permanent, où nous devons constamment veiller à ce que chaque voix compte réellement, pour empêcher le retour des hiérarchies et l’émergence de nouvelles classes dominantes.
Cet horizon désirable nous invite à en finir avec une politique confisquée par une minorité qui décide pour tous, pour la remplacer par une politique faite par toutes et tous. Alors, la politique cessera d’être une sphère séparée de la vie : elle deviendra une pratique quotidienne, intégrée à nos existences. Avec elle disparaîtra la professionnalisation du pouvoir et les étiquettes qui nous enferment.
Dans cette société nouvelle, nous ne serons plus réduits à une fonction, un métier, un genre ou une image figée de nous-mêmes, telle que veut nous l’imposer le capitalisme. Nous serons des êtres entiers, capables d’exercer plusieurs activités, d’explorer les différentes facettes de notre personnalité, d’expérimenter et de nous réinventer librement. En nous réappropriant collectivement la politique, nous nous réapproprions aussi nos corps, nos décisions et nos vies, pour bâtir une société tournée vers les besoins réels et le plein épanouissement humain.
Une société où nous choisissons ensemble comment vivre pleinement, libres des carcans imposés par le capitalisme. C’est peut-être cela, la véritable fin de l’histoire : une humanité enfin capable de se gouverner elle-même et de s’inventer chaque jour.


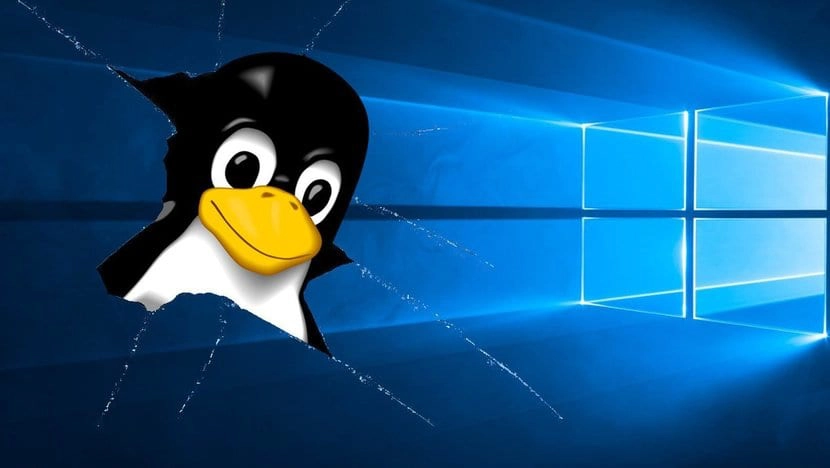



Laisser un commentaire