
Depuis deux siècles, les rêveurs de villes — et certains portés à créer des cauchemars — observent la cité avec à la fois fascination et horreur. Une minorité voulait abolir la ville, n’y voyant que murs, rues et ateliers pleins de misère pour les opprimés. D’autres au contraire voulaient renforcer esthétiquement ces mêmes caractéristiques, afin de rendre ces rues sûres contre toute insurrection. Ainsi, le Paris fraîchement remodelé par les grands boulevards du baron Haussmann n’a pourtant pas empêché la Commune de 1871. La plupart voulaient améliorer les conditions de vie des pauvres, comme dans le projet naïf des Cités-Jardins d’Ebenezer Howard à la fin du XIXᵉ siècle. Suivirent des initiatives comme l’Unité d’Habitation de Le Corbusier, qui, de prétendu projet utopique sur la planche de l’architecte, ne fut dans la réalité qu’un masque pour l’horreur de sa mise en œuvre.
Ceux qui voulaient abolir la ville, d’une manière ou d’une autre, ont gardé un certain intérêt. Par exemple, Los Angeles a vu le jour — ironiquement — comme une commune fouriériste radicale. Et l’on ne peut oublier les fantaisies imaginatives issues du constructivisme russe entre 1917 et 1925 : comme les « lacs de soupe » de Khlebnikov, ou encore des projets de villes climatiquement zonées pour satisfaire divers aspects d’une vie sociale libérée. Tout a échoué. Les « zones libérées » sont devenues de la science-fiction, ou bien un film de François Truffaut — quand elles n’étaient pas transformées à la manière Disney, célébrant à l’infini une corne d’abondance marchande, trivialisée et consacrée à l’argent et à la cupidité.
Au début des années 1950, une expérience plus sérieuse et pratique prit forme : la psychogéographie. Elle étudiait l’ambiance des quartiers populaires existants, telle qu’elle était façonnée par leurs habitants pauvres. Elle contribua ainsi à nourrir un noyau de subjectivité révolutionnaire radicale, à travers l’activité des Lettristes Internationaux, puis des Situationnistes. Cette quête passionnée d’une subversion toujours plus totale trouva son expression dans le soulèvement français du printemps 1968. Mais cette expérience ne pouvait survivre : née dans l’intervalle entre une « ville de mémoire » (faite de parcours quotidiens et improvisés) et un urbanisme conçu comme adjuvant de l’économie du spectacle marchand, elle s’effondra. Dans cette logique, les habitants ne comptaient que comme consommateurs. (On peut dire que l’errance de Thomas De Quincey dans les taudis de Clerkenwell à Londres préfigure déjà la psychogéographie). À ce point culminant de l’histoire, là encore, tout échoua.
Aujourd’hui, il nous faut tenter un nouvel effort. Ce sera probablement la dernière chance de l’humanité. L’éco-ville est-elle une solution possible ?
Bien que la critique écologique doive être une composante essentielle de la critique de l’urbanisme contemporain, les paradigmes de l’éco-ville — fondés sur les rapports sociaux de la production marchande — sont malheureusement lamentables. Les récentes inondations catastrophiques en Europe (qui auraient coûté 30 milliards de livres sterling en six ans) et ailleurs entraînent une mutation majeure des techniques hydrauliques — aussi importante que les plans visionnaires de Léonard de Vinci pour détourner l’Arno entre Florence et Pise afin d’y créer ce qui peut être vu comme le premier parc d’affaires du monde. Même si, à son époque, Léonard était le plus grand hydrologue, ses projets de canalisation des rivières relevaient davantage de la plomberie que d’une compréhension véritable de la nature même des fleuves, de leur source à leur embouchure. Il ne pouvait saisir l’importance des prairies humides, marais, drains de montagne, aqueducs ou aquifères (si l’on en connaissait alors l’existence) pour réguler les flux. Pour que cela advienne, sa vision devait être concrétisée par la géographie urbaine des plaines inondables, tandis que le rôle économique des rivières comme artères de transport était condamné à décliner.
Si nous comprenons mieux aujourd’hui le fonctionnement des fleuves, et la nécessité de les ramener à un état plus naturel, c’est uniquement parce que nous prenons conscience que la nature même des rivières a été violée — et qu’elle menace désormais ses propres violeurs. Léonard regardait ses projets pour l’Arno comme vue du ciel, anticipant ainsi la cartographie aérienne. Mais ses innovations concernaient un territoire contrôlé par les princes de la Renaissance, non par le peuple : au final, tout contrôle y était illusoire. La carte n’est pas le territoire, tel que défini par toi et moi. Une telle carte n’existe pas, et toutes celles d’hier ne sont qu’abstraction de l’homme et de la nature.
De même, la nouvelle réflexion sur les fleuves — la nécessité de créer des espaces urbains poreux pour protéger les habitants de crues périodiques de plus en plus fréquentes et dévastatrices — se déploie dans un contexte de pouvoir décroissant. Cette solution, en son essence, est technocratique. Même si elle se réclame, à juste titre, d’une approche écologique plus sensée, elle évite volontairement d’aborder les rapports sociaux du capitalisme et ne peut donc prétendre être une solution durable. La nouvelle relation homme-nature, que suppose une meilleure compréhension des fleuves, restera un pieux vœu, car la seule force capable de la réaliser — un peuple conscient et mobilisé — est écartée dès le départ. Au mieux, cela restera un simple palliatif.
La réponse des ingénieurs des rivières a été de faire partir l’eau le plus vite possible, de la drainer vers la mer à travers des lits canalisés comme de gigantesques tuyaux. Les planificateurs progressistes, eux, renversent digues et levées pour rendre aux fleuves leurs plaines inondables. Ils réintroduisent méandres et marais pour ralentir le courant, et même favorisent l’infiltration souterraine des eaux. Autrefois, quand les rivières serpentaient, les crues perdaient de leur force grâce aux zones humides, deltas intérieurs et plaines inondées. En transformant l’hydrologie complexe des fleuves en simples conduits, les ingénieurs ont en réalité aggravé les inondations.
Le Rhin est le fleuve le plus artificialisé d’Europe. Depuis deux siècles, les ingénieurs allemands ont effacé ses bras morts et l’ont coupé de ses plaines inondables. Le fleuve a perdu 7 % de sa longueur et son débit est plus rapide d’un tiers. Les quatre cinquièmes de sa plaine inondable inférieure sont barricadés : l’eau monte donc toujours plus haut, causant toujours plus de dégâts aux habitations, bureaux et routes qui s’y trouvent. Après les inondations de 1995, l’Allemagne a décidé d’abaisser le niveau du Rhin de 70 cm d’ici 2020, en restaurant 1 500 km² de plaines inondables. Les champs drainés seront remplacés par prairies humides et roselières.
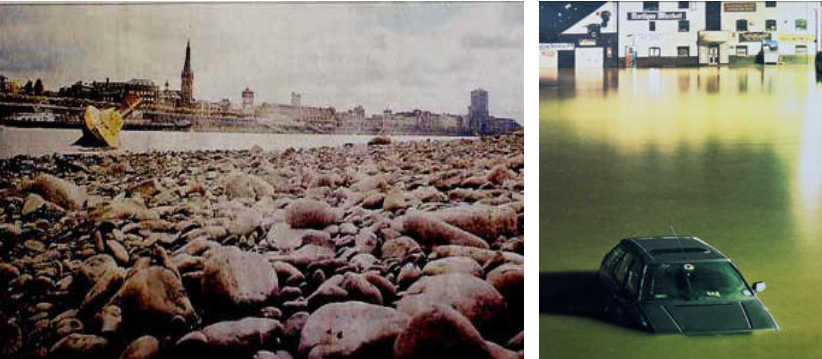
(Photo gauche : sécheresse et assèchement – le Rhin, 2004. Photo droite : l’inverse – une voiture noyée)
Les hydrologues insistent de plus en plus pour une nouvelle approche, non seulement des fleuves mais de l’ensemble du paysage. L’agence environnementale britannique déclare : « désormais, il faut travailler avec les forces de la nature. Finies les murailles de béton, place aux zones humides » (les inondations de 2000 ont coûté 1 milliard de livres). L’agence a rompu les berges de la Tamise en amont et inondé 10 km² de plaine alluviale ancienne à Otmoor, près d’Oxford.
Un dixième de tous les Européens vivent sur les plaines inondables des fleuves.
Les éco-villes d’aujourd’hui sont les villes vivantes d’hier imaginées par Archigram / Cedric Price, etc. — toutes deux évitant la question centrale de la ville et de la révolution, bien que la dispersion suburbaine tende à rendre cette formulation archaïque et floue. Même déjà dans les années 1960, ces technicistes “Little Englanders” n’avaient pratiquement jamais entendu parler de psychogéographie.
Les idioties désespérantes de Will Alsop et d’autres architectes avec leurs projets de villes techno-patrimoniales continues — comme une liaison envisagée entre Liverpool et Hull — renvoient à Archigram, mais en pire. Nous avons complètement perdu toute conception de ce que pourrait être une « nouvelle ville » en termes d’espace social libéré, tandis que l’idée même d’une « edge city » libérée n’attire personne, car elle suggère un étalement sans limites et la poursuite de la dévoration des espaces verts, tandis que les habitants, à leur tour, sont dévorés par la consommation privatisée.
Pour le moment, il n’existe qu’un éco-pragmatisme limité et compromis, absorbant l’idéal dans un utopisme pratique et restreint, totalement acceptable pour certains secteurs du capitalisme. Berlin en est leur exemple éclatant. Sur la Potsdamer Platz, un immense complexe commercial de Daimler-Chrysler limite le drainage à 3 litres par seconde et par hectare, soit seulement 1 % du ruissellement potentiel lors d’une forte tempête. Les architectes ont conçu des bâtiments qui détournent l’eau de pluie des toits pour alimenter les toilettes et irriguer les jardins suspendus. Ce développement urbain high-tech peut stocker un sixième de sa pluviométrie annuelle.
De nouveaux lotissements à travers la ville adoptent une technologie similaire. Dans la banlieue de Zehlendorf, l’eau provenant des toits, des jardins et des allées de 160 maisons est collectée pour irriguer le parc local. À Harzahn, on trouve un lotissement sans égouts de 1 800 logements sur seulement 30 hectares, avec des routes pavées qui permettent à l’eau de pluie de s’infiltrer directement dans le sol.
Il existe même des projets farfelus visant à transformer Los Angeles en éco-ville, mais dans le climat anti-environnemental actuel, cela semble peu probable. Les surfaces imperméables recouvrent 70 % de la métropole et la « la-la-land » a dépensé des milliards pour accélérer l’évacuation de l’eau lors des tempêtes intenses, en creusant d’immenses canalisations et en bétonnant les lits des rivières. Un écologiste de LA estime que la ville reçoit la moitié de l’eau dont elle a besoin via les précipitations. Un certain nombre de groupes citoyens ont émergé, tels que « Friends of the Los Angeles River » et « Unpaved LA », qui souhaitent retenir l’eau de pluie de la ville. Mais les coûts sont énormes, et de plus, les mesures de conservation sont de plus en plus considérées comme subversives aux États-Unis aujourd’hui. Ainsi, une solution traditionnelle — quel qu’en soit le coût — est bien plus susceptible de s’imposer qu’une analyse coûts-avantages rationnelle qui favoriserait la seconde. Le dernier plan à LA prévoit de dépenser 280 millions de dollars pour rehausser de deux mètres les murs en béton du fleuve Los Angeles, alors même que la ville dépense des millions chaque année pour importer de l’eau à des centaines de kilomètres de distance.
Au moment où le monde sera contraint d’adopter une solution écologique dans l’aménagement urbain, il sera déjà trop tard. La « praticité planétaire » des écologistes n’a de chance d’être mise en œuvre que dans un contexte de cauchemar global — mais, d’ici là, elle sera totalement inefficace face aux forces destructrices déjà déchaînées. Il ne nous reste qu’un court laps de temps et, à moins que la masse de la population ne commence à voir clair dans la catastrophe en cours, nous vivons véritablement sans aucun espoir d’avenir. Hélas, les chances que cela se produise diminuent de minute en minute.
par Stuart et David Wise, 2004 – publié à l’origine sur le site Dialectical Butterflies


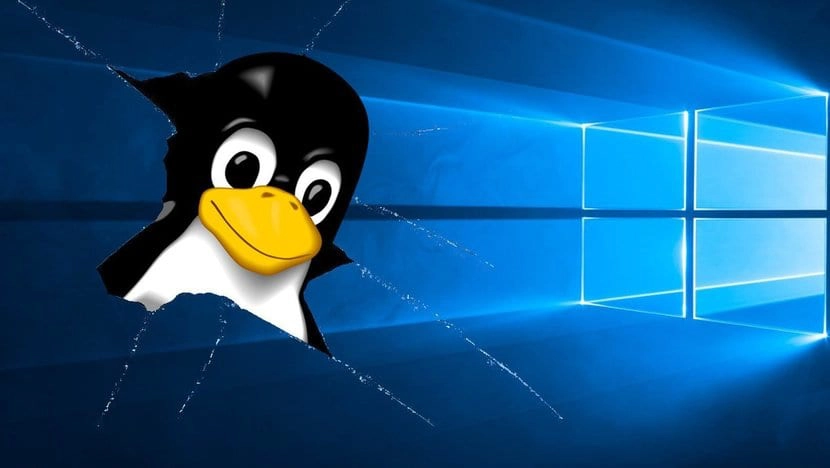



Laisser un commentaire